Ordre
Les forces aux ordres

« Au terme de son évolution, l’État tend à se retransformer en ce qu’il était à ses débuts : une bande armée. »
Anselm Jappe[1]
La police est un appendice de l’État démocratique, qui est lui-même un appendice du capitalisme. L’ordre au nom duquel les gouvernements envoient policiers et gendarmes réprimer les mouvements sociaux se revendique du bien-public, alors qu’il n’a d’autres objectifs que la circulation des marchandises et l’accumulation de plus-value – ce qui est tout autre chose. Du point de vue de la contestation des actuels rapports sociaux, l’activité des « forces de l’ordre », autrement dit des agents détenteurs de la violence capitaliste légalisée, ne sauraient être considérée comme un « travail normal ».
L’ordre, pour quoi faire ?
Après les retombées estivales de la crise dite du coronavirus, il y a fort à parier que les conséquences économiques de la gestion calamiteuse du gouvernement français, aggravées par les exigences de patrons stimulés par la situation, vont se faire cruellement ressentir, et qu’elles susciteront par-ci par-là quelques émois sociaux. Dans cette perspective, il est probable que les matraques et autres accessoires recommencent à frétiller chez les pandores, et que les muscles ramollis par quelques mois d’inactivité forcée se consacrent déjà à leur remise en condition. Bref, tout laisse à supposer que l’arsenal des répressions sociales est d’ores et déjà mis en branle. L’ordre vacillant doit se maintenir et il ne saurait renoncer à ses missions, quoi qu’il en coûte.
C’est pourquoi il ne paraît pas inutile, dès à présent, de définir quel ordre servent précisément les « forces de l’ordre », ne serait-ce que pour ne pas trop s’en laisser conter.
Car on adjoint communément au concept d’ordre les idées de concorde, d’harmonie sociale, de bonnes mœurs, de sécurité publique et individuelle, de conservation du bien public, d’encadrement assignant sa place à chacun en toute équité et selon un consentement mutuel. Mais ces associations sont fallacieuses, aussi paradoxales que les formulations orwelliennes – « La guerre, c’est la paix ; La liberté, c’est l’esclavage ; L’ignorance, c’est la force.
Il n’y a pas d’ordre en soi. L’ordre politique n’est pas une forme donnée ni souhaitable d’idéal communautaire. Il est le masque d’une hiérarchie conflictuelle, d’un rapport social d’une violence généralement sourde et parfois extrême. Il recouvre l’exercice du pouvoir d’État. Car dans le contexte d’un capitalisme mondialisé où il a renoncé à nombre de ses prérogatives, l’État national reste nécessaire. Ainsi que l’écrit Anselm Jappe dans Crédit à mort, « [la] société capitaliste moderne, fondée sur la marchandise et la concurrence universelle, a besoin d’une instance qui se charge des structures publiques sans lesquelles elle ne pourrait exister. Cette instance est l’État, et la “politique” au sens moderne (et restreint) est la lutte menée autour de son contrôle. Mais cette sphère de la politique n’est pas extérieure et alternative à la sphère de l’économie marchande. Au contraire, elle en dépend structurellement ».
L’ordre étatique de nos sociétés postmodernes est entièrement orienté vers la répression. Il suppose la mise sous tutelle et la surveillance de la population. Par le passé, le peuple français a connu au nom de l’ « ordre républicain » une colonisation analogue à celle dont les peuples autochtones des territoires d’outre-mer ont été victimes. Si cette domestication[2] entreprise au nom de la « civilisation » n’est plus guère ressentie comme telle, si elle est occultée dans le « roman national », elle n’en a pas moins eu lieu manu militari. Elle a non seulement laissé bien des cicatrices, mais surtout un vide culturel. Et ce vide culturel s’est avéré apte à se laisser combler par n’importe quel plein. C’est en quelque sorte sur ces stigmates que s’est réalisée l’assimilation aux catégories et aux valeurs du capitalisme, l’intériorisation de contraintes qui finissent par apparaître aux individus non seulement comme acceptables, mais encore comme leur première nature. La même entreprise se poursuit inlassablement sous la forme du Spectacle[3] en tant qu’entreprise de colonisation de la vie quotidienne : comme le dit Guy Debord, « La vie quotidienne, mystifiée par tous les moyens et contrôlée policièrement, est une sorte de réserve pour les bons sauvages qui font marcher, sans la comprendre, la société moderne, avec le rapide accroissement de ses pouvoirs techniques et l’expansion forcée de son marché. »[4] Et dès les années 1940, Adorno et Horkheimer ont pu décrire que les comportements les plus communs, y compris dans les rapports sentimentaux, cherchaient à s’adapter aux modèles imposés par l’industrie corporelle et la publicité.[5]
L’ordre démocratique et ses forces
La police est un appendice de l’État démocratique, comme ce dernier est celui du capitalisme – ou plus exactement son autre face, l’autre versant des marchés. Dans ce contexte, les forces de l’ordre sont, de même que l’appareil judiciaire, attachées à la queue du pouvoir exécutif comme une casserole à celle d’un chien. Cela fait donc sourire d’entendre un ministre de l’Intérieur prêcher à sa police des conseils de modération lors des interpellations au faciès ; comme dirait Stendhal, cet individu semble avoir été mis sur terre pour satisfaire notre goût du ridicule[6].
Et cela fait franchement rire de voir de bonnes âmes attendre du gouvernement qu’il se déjuge et se tape « démocratiquement » sur les doigts, au nom d’une vertu dont il viole quotidiennement les principes, à l’abri d’un Parquet tenu en laisse[7] et qui ne poursuit les débordements et les assassinats légaux qu’à seule fin de donner le change.
Quelle est en effet la proportion de flics et de gendarmes condamnés après avoir été dûment incriminés pour « bavure » ? Et à quelles peines ? L’ACAT (ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort) regrette que les « faits de violences policières donnent très rarement lieu à des sanctions effectives. Dans plus de 90% des cas étudiés par l’ACAT, les agents des forces de l’ordre n’ont pas été condamnés. […] Lorsque les agents sont condamnés, les sanctions sont faibles au regard d’autres condamnations pénales prononcées en France ». Cette association souligne notamment l’indulgence, voire la complaisance, de l’État vis-à-vis des débordements policiers : « […Le] ministère de l'Intérieur fait preuve d’une opacité flagrante concernant les violences commises par ses agents. Aucun chiffre n’est rendu public sur le nombre de personnes blessées ou tuées lors d’opérations de police ou de gendarmerie, et aucune donnée exhaustive n’est publiée sur l’utilisation des armes ou le nombre de plaintes contre des agents des forces de l’ordre pour des faits de violences. »1
C’est un désordre humain et une entreprise de pillage institués par l’ordre capitaliste que desservent les « forces de l’ordre ». On exprime cette réalité plus poliment en disant que leur rôle est de protéger la propriété. Mais quelle propriété ? Pas la part congrue des pauvres, assurément, eux qui sont dépouillés chaque jour par des exactions « normalisées ». Adam Smith, un des initiateurs du libéralisme économique, attribuait à tout pouvoir cette simple fonction : « S'il n'y a pas de propriété, il ne peut y avoir de gouvernement, car le but même de celui-ci est de protéger la richesse et de défendre les riches contre les pauvres. » Défendre les riches contre les pauvres, tel est l’apostolat des « forces de l’ordre ».
La violence commanditée par l’État s’exerce au nom de la Loi, ce qui la couvre du manteau de la légitimité démocratique. Mais qu’est-ce que la Loi ? C’est la volonté officiellement formulée de l’État. On pourrait à l’extrême rigueur considérer comme légitime un monopole étatique de la violence si l’État était la forme adoptée par une réelle souveraineté populaire. Mais ce n’est pas le cas de nos démocraties représentatives – qui ne sont pas plus démocratiques qu’elles ne sont représentatives. Comme le disait Hegel, l’État est donc la forme de pouvoir que se donne une faction : « Le gouvernement, une décision et une exécution qui procèdent d’un point, veut et exécute en même temps un ordre et une action déterminés. Il exclut donc d’une part les autres individus de son opération, et d’autre part il se constitue lui-même comme tel qu’il soit une volonté déterminée, et de ce fait soit opposé à la volonté universelle. Le gouvernement ne peut donc pas se présenter autrement que comme une faction. Ce qu’on nomme gouvernement, c’est seulement la faction victorieuse, et justement dans le fait d’être faction se trouve immédiatement la nécessité de son déclin ; et le fait qu’elle soit au gouvernement la rend inversement faction et coupable. »[8]
Et quelle est la volonté pérenne de cette faction ? C’est de maintenir les rapports humains tels qu’ils sont déterminés par la concurrence effrénée propre à la société « libérale » ; c’est d’exprimer non pas les nécessités du bien public, mais les impératifs capitalistes, qui exigent de forcer les populations au travail abstrait, sans se soucier de leurs besoins, de manière à assurer la circulation des marchandises (de l’argent) et l’accumulation de valeur. L’État, qui se prétend neutre, est une organisation radicalement séparée de la population, un organisme d’exploitation, d’assujettissement et de contrôle, préservant la seule liberté du capital[9]. C’est l’instrument de domination d’une classe socio-économique. Une classe qui du reste épure chaque jour ses rangs en les paupérisant, et qui se réduit à une caste. La nature maffieuse de cette caste est aujourd’hui manifeste. Elle est sans foi, sans loi, sans autre morale que son insatiable cupidité, sans projet autre que son maintien aux affaires en dépit de tout. Comme dit Debord, « [le] gouvernement du spectacle, qui à présent détient tous les moyens de falsifier l’ensemble de la production aussi bien que de la perception, est maître absolu des souvenirs comme il est maître incontrôlé des projets qui façonnent le plus lointain avenir. Il règne seul partout ; il exécute ses jugements sommaires ».[10]
Les forces de l’ordre sont donc engagées sous les ordres des gouvernements dans une conflictualité permanente, latente ou explosive, où elles sont placées en dehors de toute politique de protection du citoyen, à l’extérieur de la sphère de la « souveraineté nationale » – ce qui les prive objectivement de toute légitimité.
Les « forces de l’ordre » sont exclusivement au service de ce désordre humain et de cette entreprise de pillage qu’est l’ordre capitaliste. On exprime cette réalité plus poliment en disant que leur rôle est de protéger la propriété. Mais quelle propriété ? Pas la part congrue des pauvres, assurément, eux qui sont dépouillés chaque jour par des exactions « normalisées » et acculés à l’indigence. La loi Quillot de 1982 a fait du droit à l’habitation un droit fondamental ; elle a été consacrée en 1990 par la loi Besson. Pour autant, a-t-on jamais vu les « forces de l’ordre » s’opposer aux injonctions d’un huissier expulsant une famille de chez elle et la jetant à la rue ?
La seule forme de propriété protégée par les forces de l’ordre capitaliste est celle des plus riches d’entre les riches. Adam Smith, un des initiateurs du libéralisme économique, attribuait à tout pouvoir cette simple fonction : « S'il n'y a pas de propriété, il ne peut y avoir de gouvernement, car le but même de celui-ci est de protéger la richesse et de défendre les riches contre les pauvres. » Défendre les riches contre les pauvres, tel est, clairement défini, l’apostolat des « forces de l’ordre ».
Certains considèrent cependant que l’État est la providence des bonnes gens, que la violence policière ne frappe que des coupables, qu’elle les désigne même, et donc qu’elle épargnera toujours les innocents – surtout s’ils sont blancs et solvables. Ceux-là font une lourde erreur : ils ignorent, oublient ou refusent de voir que nous vivons au temps d’un « capitalisme de surveillance »[11], qu’aux yeux de l’État et des entreprises spécialisées qui sondent les cœurs et les reins de chacun au moyen d’une technologie de plus en plus sophistiquée et invasive, chaque citoyen est suspect – et peut-être d’autant plus qu’il ne sait pas de quoi. Et que cette suspicion censément sécuritaire excède largement et de tout côté la lutte contre les diverses formes de criminalité. C’est ainsi que Google a développé des algorithmes permettant de cerner les pensées, les sentiments, les intentions et les intérêts des individus et des groupes, y compris ceux qu’on ignore soi-même, sans se soucier d’obtenir le consentement de quiconque.
La violence de la police répond à la sauvagerie de l’État démocratique. La mort de Zyed Benna et de Bouna Traoré, le 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois, est à l’origine d’émeutes qui se sont étendues à l’ensemble du territoire national pendant plus de trois semaines. Tout comme aujourd’hui avec l’affaire Adama Traoré, ces manifestations se sont dirigées contre les forces d’ordre. Pourtant, la question se pose : qui faut-il prioritairement condamner, ne serait-ce que d’un point de vue « moral » : la main qui exécute ou la tête qui commande, qui permet les débordements, et plus encore les encourage ?
Les agents de l’ordre ou la banalité du mal
« [Le] fonctionnaire, race dont l’existence pose des problèmes humains d’une grande complexité. »
Sebastian Haffner[12]
Bien évidemment, le fait que la violence exercée par les forces de police soit en fait celle de l’État capitaliste ne dédouane en rien les policiers et les gendarmes[13] (voire les militaires employés occasionnellement au maintien de l’ordre) qui s’y soumettent.
Lors des émeutes de ces dernières années, on a entendu politiciens et éditocrates pousser des cris d’orfraie à la moindre brutalité des manifestants. En effet, selon le discours officiel, policiers et gendarmes devraient être considérés comme intouchables, plus encore que les autres effectifs de la fonction publique (même s’ils sont aussi mal rémunérés), parce que leur mission essentielle est de préserver de leur corps un sanctuaire laïque moralement inviolable, la « République », avalisé par le suffrage universel. C’est en tant que tels qu’ils devraient bénéficier de l’immunité attachée à la sacralité des institutions qu’ils sont chargés de protéger.
Mais pour l’État capitaliste, il n’est rien de sacré, sinon lui-même, ses intérêts à court terme, et la pérennité de la loi du profit. Le président s’est récemment complu à parler de guerre dans plusieurs de ses verbigérations sur le coronavirus, et cela ne s’est traduit que par des mesures palliatives. Mais son principal ennemi, celui contre lequel il ne manque jamais d’envoyer effectivement ses troupes, c’est la population.
L’État, c’est aussi ce qu’en font ceux qui sont aux affaires. Pour Maurice Rajsfus (A vos ordres ? Jamais plus), « L'ordre public, c'est l'ordre brutal mis au service du pouvoir quel qu'il soit ». Or n’importe qui peut se retrouver au pouvoir. Un homme lige des banksters, par exemple – mais on peut redouter bien pire. N’oublions pas non plus que si de Gaulle est parvenu à ses fins par une manière de coup d’État, Hitler, pour sa part a été élu très démocratiquement.
Il paraît bien lointain le temps pourtant bien agité de Mai 68, où le préfet Maurice Grimaud, se disant soucieux d’éviter un bain de sang, adressait à ses policiers, une lettre individuelle en date du 29 mai portant les recommandations suivantes : « Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Il est encore plus grave de frapper des manifestants après arrestation et lorsqu'ils sont conduits dans des locaux de police pour y être interrogés. Je sais que ce que je dis là sera mal interprété par certains, mais je sais que j'ai raison et qu'au fond de vous-mêmes vous le reconnaissez. »[14] On n’ose imaginer quel aurait été le tableau chasse d’un Didier Lallemant, l’actuel ordonnateur des folies parisiennes, au terme de ces journées mémorables.
Alors, en quoi le fait que les forces de l’ordre soient les défenseurs des bijoux de famille et des privilèges des rupins, et qu’elles soutiennent une politique économique d’une insupportable violence à l’endroit des démunis, doit-il nécessairement leur donner une dignité et un statut particuliers et leur assurer une sereine immunité lors des affrontements sociaux ? Pourtant, s’opposer physiquement à elles est un crime de lèse-majesté justiciable d’une comparution immédiate et de la prison. Comme le disait notre Narcisse national en février 2019, on ne touche pas à ceux qui ont pour mission de mater le peuple souverain dès que ce dernier a l’impudence de s’exprimer de manière autonome et hors des cadres imposés : « Je ne laisserai pas les forces de l'ordre sans aucun moyen ni d'assurer l'ordre public, ni de se défendre face à des gens qui arrivent aujourd'hui armés et avec les pires intentions. »[15] Le fait de revendiquer pour sa dignité ou simplement pour qu’une activité salariée permette de se nourrir décemment, non seulement suffit à exclure d’une citoyenneté « respectable », mais renvoie à un statut de malfrat.
Les forces de l’ordre sont en réalité les dignes héritiers des Gardes suisses, ce régiment d’infanterie affecté à la protection de la Maison du roi depuis le XVIe siècle et jusqu’à 1830 : ce sont des mercenaires, aux ordres de la faction politique qui les paie, quelle qu’elle soit.
Mais l’aspect le plus scandaleux dans cette conception de l’ordre et de son maintien est le fait d’accorder à ces mercenaires le statut de travailleurs ordinaires, ce qui revient à intégrer le droit de tuer dans le cadre d’un « travail » officialisé. Autrement dit à banaliser et à légaliser des crimes pour raison d’État. – ce qui est propre à tourner la tête à plus d’un. D’apparence anecdotique, ce fait a des conséquences fondamentales, puisqu’il revient à intégrer le droit de tuer dans le cadre d’un simple « travail » officialisé, soit à banaliser et à légaliser des crimes pour raison d’État aux yeux des tueurs potentiels eux-mêmes.
Günther Anders remarque que, dans la pensée de la domination industrielle, « il est courant de faire passer des activités qui en vérité ne sont pas des “travaux” pour des “travaux” ». Il prend pour exemple Auschwitz et Hiroshima. « Ces anéantissements, qui en vérité ont été des actes, et à vrai dire des actes criminels, ont été assignés à ceux qui ont dû les commettre comme on assigne des “travaux”, des “jobs”. […] Puisqu’en tant que créatures de l’ère industrielle [ces derniers] avaient appris que le travail n’a pas d’odeur, qu’il est une occupation dont, au fond, le produit final ne nous concerne pas, nous et notre conscience, ils ont accompli sans discuter la mission de tuer en masse qui leur avait été assignée sous l’étiquette “travail”. Sans discuter parce qu’avec la meilleure des consciences. Avec la meilleure des consciences, parce que sans conscience. Sans conscience, parce que dispensés d’avoir une conscience par la façon même dont leur mission leur a été assignée. »[16]
Propos excessifs ? Nullement, tant la réalité est elle-même obtuse et outrancière. Prenons un cas exemplaire de percuteur chatouilleux : en 2008, dans le Var, un adjudant de gendarmerie tire à sept reprises sur un jeune homme de 26 ans, l’atteint de trois balles et le tue alors qu’il tentait de s'échapper des locaux de la gendarmerie de Draguignan, où il était entendu, menotté, dans le cadre du garde à vue. En septembre 2010, la cour d’assises de cette ville acquitte le gendarme, jugeant qu'il a accompli « un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou réglementaires ». L’avocat général Philipe Guémas avait déclaré : « Il ne s'agit pas de délivrer un permis de tuer, mais de constater que [l’adjudant] a agi conformément à ce qui lui a été enseigné. Il a agi dans le cadre légal, il n'a pas agi pour commettre une infraction pénale »[17]. Pour finir, en 2014, la Cour européenne des droits de l’homme, considérant que « d'autres possibilités d'action s'offraient au gendarme pour tenter l'arrestation de Joseph Guerdner, au lieu d'ouvrir le feu », a désavoué ce jugement en indemnisant la famille[18]. Jérôme Laronze, un paysan de 37 ans, a été tué par un gendarme le 20 mai 2017 à Sailly, en Saône-et-Loire. Trois balles l’ont atteint, une de côté et deux de dos, alors qu’il s’échappait au volant de sa voiture. Il était recherché depuis le 11 mai 2017 (alors que trois des contrôles subis par Jérôme Laronze étaient irréguliers) : ce jour-là, l’administration venait lui retirer ses vaches et il avait pris la fuite.
On peut ici souligner que si le port d’armes à feu permanent auquel sont autorisées les « forces de l’ordre » ne semble pas faire problème en France, et s’il est de bon ton d’en faire professionnellement usage dans le contexte du désarmement général de la population, il en va parfois bien autrement ailleurs. En Grande-Bretagne notamment, il était de tradition que la police ne soit pas armée : « [Depuis] 1936, très peu d’officiers de police portent une arme à feu. En 2014, seuls 4,5 % d’entre eux (5 875 sur 129 584) étaient autorisés à en posséder une, que, sauf cas très exceptionnel, ils n’ont pas le droit de rapporter à leur domicile. Tous appartiennent au département SCO19, “ chargé de fournir le soutien armé à nos collègues non armés ”, un service créé en 1966 après le meurtre de trois policiers en civil. » En outre, les policiers britannique eux-mêmes s’étaient en majorité déclarés hostiles au port d’arme : « En 2006, 82 % des membres de la Fédération de la police avaient indiqué être favorables au non-port d’armes, bien que la moitié d’entre eux aient admis avoir été “en sérieux danger” au cours des trois années précédentes. Même le meurtre de policiers ne les fait pas changer d’avis. “Nous savons grâce aux expériences aux États-Unis et dans d’autres pays qu’avoir des officiers armés ne signifie pas qu’ils ne se font pas tuer”, soulignait en 2012 le responsable de la police de Manchester après la mort de deux de ses officiers. »[19] Seuls les attentats terroristes revendiqués par l’État islamique ont incité à infléchir cette politique[20].
Souvenirs, souvenirs
S’il n’y a sans doute pas lieu pour autant d’assimiler les forces de l’ordre à des criminels de guerre ou de masse, un passé encore proche est riche d’exemples où elles se sont comportées de la sorte, en France, en répondant aveuglément à des ordres. Rappelons la barbarie à l’encontre de la population ouvrière en révolte au cours de ces deux derniers siècles. Les mains sectionnées et les yeux crevés des Gilets jaunes en 2018-2019 ne l’ont pas été par des matraques en sucre d’orge et des LBD en marshmallow.
Rappelons également la rafle du Vél-d’Hiv menée par la police de Vichy en juillet 1942, et précisons que pour cette opération qui a vu l’arrestation de 13 152 juifs dans Paris et sa banlieue, précédant leur déportation et menant 4 000 enfants à la mort, pas un seul soldat allemand ne fut mobilisé. C’était l’œuvre de fonctionnaires obéissants.
Rappelons encore ce qu’a été l’ordre français pour les pays colonisés. Par exemple, en Algérie, autour de Sétif et de Guelma, la répression sauvage des émeutes ayant suivi une manifestation organisée par des partis indépendantistes fit entre 20 000 et 30 000 morts du côté algérien le 8 mai 1945[21].
Rappelons enfin le massacre du 17 octobre 1961 à Paris, où plus de deux cents algériens furent assassinés par la police. On peut lire dans Le Monde du 17 octobre 2011 : « A cinq mois de la fin de la guerre d'Algérie, le 17 octobre 1961, Paris a été le lieu d'un des plus grands massacres de gens du peuple de l'histoire contemporaine de l'Europe occidentale. Ce jour-là, des dizaines de milliers d'Algériens manifestent pacifiquement contre le couvre-feu qui les vise depuis le 5 octobre et la répression organisée par le préfet de police de la Seine, Maurice Papon. La réponse policière sera terrible. Des dizaines d'Algériens, peut-être entre 150 et 200, sont exécutés. Certains corps sont retrouvés dans la Seine. Pendant plusieurs décennies, la mémoire de cet épisode majeur de la guerre d'Algérie sera occultée. »[22]
Mais en fait, alors que le système politico-économique produit absolument n’importe quoi au nom de la croissance infinie du capital, il est logique et nécessaire que les forces de police soient par principe disposées à exécuter sans état d’âme et intégralement n’importe quelle mission du moment que l’ordre leur en est donné. Et cela quelle que soit l’iniquité de la loi qu’on leur intime d’appliquer, quelle que soit la nature du pouvoir qui a autorité sur elles. Hannah Arendt précise qu’Adolf Eichmann, responsable de la logistique de la « solution finale » des nazis, « agissait dans tout ce qu’il faisait en citoyen qui obéit à la loi. Il faisait son devoir, répéta-t-il mille fois à la police et au tribunal ; non seulement il obéissait aux ordres, mais il obéissait à la loi. »[23] Et c’est justement par leur zèle à obéir sans état d’âme que les forces de l’ordre sont un organe totalitaire : comme le dit Günther Anders, « l’essence de l’État totalitaire consiste justement à effacer la dualité du “légal” et du “moral” ».
Christopher Browning, dans Des hommes ordinaires. Le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne, ouvrage consacré à un des groupes de l’Ordnungspolizei qui, derrière le front russe, ont été chargés de l’extermination des Juifs polonais en 1942, constate combien il est aisé de transformer des hommes ordinaires en « bourreaux volontaires ». Cet auteur insiste ce faisant sur le phénomène de déstructuration mentale et morale induit par l’esprit de corps combiné à l’autorité bureaucratique déléguée par l’État : « Tout aussi important fut l’esprit de corps – l’identification élémentaire de l’homme en uniforme avec ses frères d’armes et l’extrême difficulté qu’il éprouve à faire cavalier seul. […Quitter] les rangs […] signifiait abandonner ses camarades et revenait à admettre qu’on était “faible”, voire “lâche”. » Sous l’uniforme, il passe pour plus viril d’être abject avec les autres que digne tout seul. Selon cet auteur, en la qualité de soldats et de policiers, des individus « peuvent commettre des actes qu’ils jugeraient répréhensibles s’ils les faisaient de leur propre chef, mais auxquels ils ne trouvent rien à redire du moment qu’ils sont approuvés par l’État ».
Adolf Eichmann, responsable de la logistique de la « solution finale », se considérait lui-même non comme un nazi mais comme un fonctionnaire zélé et donc un simple exécutant. Hannah Arendt, qui lisait en lui la « banalité du mal », montre clairement à quoi peut mener l’universalité des principes et du conformisme – soit tout ce qui exclut qu’on passe les choses de la vie au crible de la conscience individuelle : « C’était ainsi, c’était la nouvelle loi du pays, fondée sur l’ordre du Führer ; autant qu’ [Eichmann] pût en juger, il agissait, dans tout ce qu’il faisait en citoyen qui obéit à la loi. Il faisait son devoir, répéta-t-il mille fois à la police et au tribunal ; non seulement il obéissait aux ordres, mais il obéissait à la loi. »[24]
Primo Levi, dans Les Naufragés et les Rescapés, retrouve le même type de défense chez les simples exécutants nazis : « [Nous] avons été éduqués à l’obéissance absolue, à la hiérarchie, au nationalisme ; nous avons été abreuvés de slogans, enivrés de cérémonies et de manifestations ; on nous a appris que la seule chose juste était celle qui profitait à notre peuple et que la seule vérité était les paroles du Chef. […] Nous avons été des exécutants zélés et nous avons été félicités et promus pour notre zèle. [… D’autres] ont décidé pour nous, et il ne pouvait en être autrement, parce que nous avions été amputés de la capacité de décider. »
Le poids de l’universalité des principes et du conformisme est terrible sur les consciences en déroute. L’histoire a tant de fois montré combien il est aisé à des injonctions bureaucratiques de transformer des hommes ordinaires en « bourreaux volontaires », et que ce phénomène est favorisé par la déstructuration mentale et morale induite par le port d’un uniforme, en tant que symbole de l’esprit de corps.
Toujours est-il qu’il est bien malaisé de traiter comme des fonctionnaires ordinaires des êtres dont la déontologie repose sur la négation de toute indépendance d’esprit et de toute valeur humaine, et qui se mettent en rupture d’humanité.
*
* *
Nous sommes décidément bien pusillanimes à nous réfugier derrière de tels maîtres. En définitive, mieux vaudrait valoriser la confusion et le désordre propre à tout comportement autonome : bien plus que l’ « ordre », l’ « autorité », l’ « obéissance », ce sont les éléments de toute vie. La question serait alors : comment vivre socialement dans le désordre ? Les anciens Grecs avaient eu une idée bien proche, en intégrant dans leur panthéon, au sein de la Cité, Dionysos, le dieu de l’ivresse, des excès, de l’extase, de la folie[25].
23 septembre 2020 © corédigé avec Gérard Dressay de la Boufette
[1] L’Avant-garde inacceptable. Réflexions sur Guy Debord, Éditions Léon Scheer, 2004, p.38.
[2] Phénomène incluant, outre la conversion forcée de la paysannerie en main-d’œuvre industrielle, l’éradication par la force des cultures populaires et des particularismes locaux.
[3] Dans Commentaires sur la société du spectacle, Debord définit le Spectacle moderne comme « le règne autocratique de l’économie marchande ayant accédé à un statut de souveraineté irresponsable, et l’ensemble des nouvelles techniques de gouvernement qui accompagnent ce règne » (Éditions Gérard Lebovici, 1988, II, p.12).
[4] « Perspectives de modifications conscientes dans la vie quotidienne », Internationale situationniste n°6, août 1961, p.22.
[5] La Dialectique de la raison (Gallimard, 1974, p.176).
[6] « Notre célèbre poète, Casimir Delavigne, a refusé la pension annuelle de douze cents francs que le roi voulait lui faire. Aussitôt chacun de se dire : “Si vraiment M. Sosthène de la Rochefoucauld n’existait pas, on ne rirait plus à Paris.” C’est, en effet, ce noble vicomte, mis sur terre pour satisfaire notre goût du grotesque, qui a encore attiré cet affront à la royauté. » (Courrier anglais, Lettre du 18 mai 1825.)
[7] La loi du 9 mars 2004, dite Perben II, a introduit le Garde de Sceaux, membre de l’exécutif, comme le véritable organe de la procédure pénale. Il peut ainsi adresser aux procureurs généraux et aux procureurs de la République des directives générales de politique pénale (art. 30 CPP). Comme la carrière d’un magistrat du parquet dépend de sa hiérarchie, la Cour européenne des droits de l’Homme a affirmé dès 2010 que le procureur français n’est pas « une autorité judiciaire indépendante ».
[8] Phénoménologie de l’esprit, II, p. 136.
[9] « Messieurs, ne vous en laissez pas imposer par le mot abstrait de liberté. Liberté de qui ? Ce n’est pas la liberté d’un simple individu en présence d’un autre individu. C’est la liberté qu’a le capital d’écraser le travailleur » (Marx, Discours sur la question du libre-échange, 1848, in Kurz, Lire Marx, p.312).
[10] Commentaires sur la société du spectacle, op. cité, p.20.
[11] Selon l’expression de Shoshana Zuboff, sociologue et femme de lettres américaine, professeur émérite à la Harvard Business School.
[12] Histoire d’un Allemand, souvenirs 1914-1933, nouvelle édition augmentée, Actes Sud, 2003, p.152.
[13] On distinguera ici la gendarmerie territoriale, « force de proximité au contact de la population, [qui] assure la sécurité des personnes et de leurs biens 24 heures sur 24 » (https://www.lagendarmerierecrute.fr/Metiers/Unite-territoriale), de la gendarmerie mobile (compagnies de CRS et les escadrons de gendarmerie mobile), qui consacre tous ses talents au maintien de l’ordre. C’est donc plus particulièrement de ces derniers, les Robocops de la « famille », qu’il est ici question.
[14]https://www.lemonde.fr/le-monde-2/article/2008/05/16/la-lettre-de-maurice-grimaud-aux-policiers_1046120_1004868.html.
[15] http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2019/02/27/01016-20190227ARTFIG00280-macron-defend-l-usage-du-lbd-malgre-les-critiques-de-l-europe-et-de-l-onu.php. Nul ne sait dans quel fantasme ténébreux lesdites armes ont été repérées…
[16] L’Obsolescence de l’homme, II, p.166-167.
[17] Le général de division Marc Mondoulet, commandant de la gendarmerie dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, commentait l’acquittement du gendarme en ces termes : « Les jurés ont confirmé que l'adjudant Monchal a fait usage de son arme dans les conditions fixées par la loi. » Pourquoi en effet un « permis de tuer » personnalisé, quand ce droit est inscrit dans le règlement et plus généralement dans la loi ?
[18] On peut lire dans l’arrêt du 17 avril 2014 de cette Cour : « S’agissant de l’obligation positive de mettre en place un cadre législatif et adéquat approprié, la Cour rappelle notamment que “ le cadre juridique national régissant les opérations d’arrestation doit subordonner le recours aux armes à feu à une appréciation minutieuse de la situation et, surtout, à une évaluation de la nature de l’infraction commise par le fugitif et de la menace qu’il représente. De surcroît, le droit national réglementant les opérations des forces de l’ordre doit offrir un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force, et même contre les accidents évitables [CEDH, arrêt de Grande chambre du 20 décembre 2004, Makaratzis c. Grèce, req. n° 50385/99, § 58]. En particulier, les représentants de la loi doivent être formés pour être à même d’apprécier s’il est ou non absolument nécessaire d’utiliser les armes à feu, non seulement en suivant la lettre des règlements pertinents mais aussi en tenant dûment compte de la prééminence du respect de la vie humaine en tant que valeur fondamentale” (§ 64). »
Considérant que dans le cas de Joseph "d'autres possibilités d'action s'offraient au gendarme pour tenter l'arrestation de Joseph Guerdner, au lieu d'ouvrir le feu" (§ 72), elle a condamné la France à verser pour 67 500 euros d’indemnités à la famille.
[19] https://www.la-croix.com/Actualite/Europe/En-Grande-Bretagne-les-bobbies-n-ont-pas-d-armes-a-feu-2015-07-22-1336976
[20] https://www.lesechos.fr/2018/05/face-aux-terroristes-la-police-britannique-va-sarmer-972582.
[21] Cf. Noiriel, Une histoire populaire de la France, p.623.
[22] https://www.lemonde.fr/societe/article/2011/10/17/17-octobre-1961-ce-massacre-a-ete-occulte-de-la-memoire-collective_1586418_3224.html.
[23] Eichmann à Jérusalem.
[24] Eichmann à Jérusalem, « Quarto »-Gallimard, p.1149.
[25] Jean-Pierre Vernant, Œuvres I, Mythe et religion en Grèce ancienne, « Dionysos, l’étrange étranger », p.864 sq.
Brève conclusion des "forces aux ordres"
Les forces aux ordres sont ennemies de la liberté
Par Daniel Adam-Salamon, le 25 mars 2024
En hommage à mon camarade Jérôme Laronze, abattu de trois balles par un gendarme.
Introduction
L’ordre est un concept qui s'impose avec autorité dans le discours social. On l'évoque souvent comme idéal communautaire, comme vision d’une société harmonieuse fonctionnant mécaniquement au bien-être de tous. Or, l’ordre politique est tout autre : un masque d’harmonie sur l'asymétrie du pouvoir.
L'ordre et le pouvoir d'État
Dans un capitalisme mondialisé, le pouvoir politico-économique impose sa conception du monde, non comme un idéal mais comme un fait accompli. Par définition, l'État est le gardien de cet ordre contraignant, et toute idée d'État sans cet ordre est illusoire.La contrainte étatique.
Aucun État ne peut fonctionner sans imposer un ordre spécifique.
Le travail forcé et les impôts extorqués sans ménagement sont des formes pernicieuses de cette contrainte. Ainsi fonctionne l`'ordre' étatique : sur l'exaction et l'extorsion.
L’emprise étatique sur l'être et l'avoir
Tout État cherche à s'étendre sur chaque aspect de la vie privée et sur tout être défini comme son ressortissant. Cette emprise ignore en essence la dichotomie entre public et privé, tentant d'annuler l'un au profit exclusif de l'autre.
L’ordre politico-militaire
Les institutions chargées de l'ordre, armée et police, ne sont pas des entités ordinaires : elles opèrent dans un cadre d'administration par la violence. Cette violence est institutionnalisée et, ainsi, sanctifiée par l'État.
L'illusion sécuritaire
L’État capitaliste crée une illusion de bien commun, de sécurisation, pour légitimer ses actions. Mais cette sécurité n'est que l'équilibre précaire entre les biens des uns et la précarité des autres, entre la propriété et la convoitise, génératrice de conflit.
Les échos de l'histoire
Ainsi, la répression impitoyable des différentes émeutes et manifestations à travers l'histoire, telle que la rafle du Vél-d’Hiv ou le massacre du 17 octobre 1961, illustrent ce maintien de l’ordre toxique qui vise davantage à asseoir la suprématie étatique et à éradiquer toute dissonance plutôt que de protéger véritablement ses citoyens.
Avec les forces de l’ordre, pas de liberté
Les forces aux ordres ne peuvent être considérées comme des travailleurs ordinaires, car leur travail inclut le droit de tuer pour raison d'État. Cette légitimité offerte à la violence d’État est une attaque frontale contre la liberté.
Conclusion
Nous devons rester vigilants face aux discours qui normalisent la violence d'État et qui en banalisent l'exécution par les forces de l'ordre. Que ce soient des exactions passées ou des violences actuelles, chaque acte posé par ces institutions contre la population doit être scruté et jugé à l'aune de notre désir commun de liberté et d’humanité.La réalité de l’ordre étatique pose alors une question inévitable : pouvons-nous vraiment parler de liberté dans un environnement où l’État se réserve le droit de manier la violence impunément ? J'argue que tant que les forces aux ordres demeurent des instruments de répression à la discrétion d'un pouvoir non irréprochable, la liberté reste illusoire. La société que nous aspirons à bâtir doit transcender cette conception de l'ordre et trouver un équilibre plus juste et plus humain.
Les enfants de Moissac
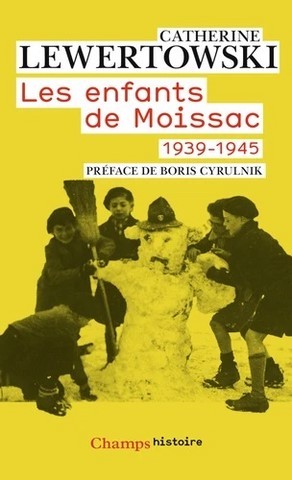
Les Enfants de Moissac : une leçon de désobéissance pour aujourd'hui !
Cela fait 84 ans cet été que démarrait une aventure extraordinaire : celle qui, malgré le joug imposé au pays par l'Etat Français du Maréchal Pétain puis directement par l’occupant nazi, allait permettre à un demi-millier d’enfants et adolescents juifs d’échapper aux rafles, à la déportation, à la mort. Une histoire dont vous n’avez probablement jamais entendu parler, car les leçons qu’elle donne déplaisent à tous les pouvoirs 1.
Car contrairement à la version officielle qu'on essaie de nous faire gober, la Résistance et la protection des enfants juifs contre les déportation ne fut pas le fait de "policiers courageux qui choisirent le maquis" mais au contraire de gens très ordinaires qui ont désobéi à la police ...
Il y a en effet 80 ans, plus précisément en juillet 1939, que les Eclaireurs israélites de France devenaient occupants à Moissac (Tarn-et-Garonne) d’un bâtiment qui existe toujours, au 18 quai du Port, auxquels ils annexeront progressivement quelques autres bâtisses. Ils poursuivaient un grand objectif : à l’aube d’une période qu’ils anticipaient comme tragique, ouvrir une maison d’enfants.
Du début à la fin de la guerre quelques cinq cents enfants et adolescents juifs passeront par là. Ils y seront pris en charge, d’abord directement par un hébergement sur le site, puis, quand la rafle du Vel’d’hiver sonnera pour eux le début de la clandestinité, par un soutien sans faille dans les multiples planques qui avaient été recherchées en temps utiles.
Les plus jeunes avaient à peine 2 ans. Tous ces enfants avaient vécus une séparation d’avec leurs parents (parents souvent raflés, déportés, assassinés). Beaucoup avaient commencé à traversers les horreurs de la guerre, surtout les "étrangers". Certains ne parlaient que leur langue à l’arrivée. D’autres avaient été extirpés, cadavériques et traumatisés, des camps français (Septfonds, Gurs, Le Vernet, Noé, Agde...). Beaucoup n’avait plus de famille. Ceux qui animèrent la maison puis son réseau clandestin n’étaient guère plus âgés qu’eux. Ils avaient 17, 18, 20 ans, rarement plus. Plusieurs, torturés, déportés, fusillés, payèrent de leur vie cet engagement.
Mais, aussi extraordinaire que cela puisse paraître, malgré la police française, malgré la milice, malgré la gestapo, pas un des "Enfants de Moissac", pas un de ces enfants recueillis et cachés ne fut pris et déporté 2.
Action de la police française sous Vichy : une tâche digne d'"éloges"
76 000 autres juifs en France n’ont pas eu cette chance. Eux ont l’ont été, déportés. Bien peu en sont revenus. A 90 %, ils ont été arrêtés non pas par les nazis mais par la police française*3. Toutes les forces de police ont apporté leur contribution à l’organisation du génocide. Les services "anti-juifs" spécialisées du ministère de l’intérieur bien sûr, mais aussi la gendarmerie et même la police municipale. Cette dernière a joué un rôle essentiel dans les rafles mais surtout par son action au quotidien, lors des contrôles "au faciès". A Paris, des juifs "sans papier", aux papiers périmés, à l’étoile jaune pas assez visible, ou pris sous n’importe quel prétexte étaient arrêtés chaque jour par les "municipaux", immédiatement conduits en "panier à salade" au camp de rétention de Drancy, et de là acheminés vers les camps d’extermination. Une noria savamment entretenue.
Quant à la police nationale, tous les services s’y mirent sans complexe, dépassant même leurs attributions habituelles. Ainsi, pour la première fois, les "Renseignements généraux" avaient organisé une brigade de la voie publique. Comme les "municipaux", cette brigade "tapait aux papiers et contrôlait au faciès sur la voie publique à la recherche d’israélites... "*3. Les bureaucrates du ministère de l’intérieur ne furent pas en reste : le fichier juif, mis au point par des policiers français, "suscita l’admiration et la convoitise des services allemands et servit à organiser les rafles de mai1941 à février 1944" 3.
Même si certains policiers ont appliqué mollement les consignes "... les pouvoirs des policiers, leurs prérogatives, leur savoir faire professionnel ont donné aux ordres qu’ils recevaient, une efficacité, des conséquences dramatiques" 4
De façon tout à fait indéniable, la police française a donc, par son action, rendu possible l’exécution de la "solution finale", c’est-à-dire l’extermination des juifs du pays. Car "Toute action des policiers, même remplie avec répugnance leur a fait alimenter la machine à broyer" 5.
Les nazis ne se sont pas trompés sur la valeur de la contribution apportée au génocide par la police française. Ainsi, à la suite de la rafle des 16 et 17 juillets 1942 (considérée pourtant comme l’une des "moins réussies" par la préfecture de police), l’Höhere SS und Polizifuhrer in Frankreich Oberg publiait le message de satisfaction suivant : "Je vous confirme bien volontiers que la police française a réalisé jusqu’ici une tâche digne d’éloge." 6
Protégés par la population
Pourquoi la police française, dont le professionnalisme et l’efficacité ont été couverts d’éloges - à juste titre si on ose l’écrire tant le constat est abominable - par les nazis a-t-elle échouée dans sa traque des enfants de Moissac ? Les raisons en sont à l’évidence multiples. Tout d’abord, l’extraordinaire clairvoyance de la situation, la perspicacité, l’altruisme et le courage dont firent preuve les animateurs de la maison d’enfant. Ensuite, certainement aussi, le soutien financier, jamais interrompu, de la communauté israélite. D’autres raisons aussi, probablement.
Mais, qu’aurait valu tout cela sans le soutien de la population locale ?
Longtemps après les faits, Shatta Simon, la principale animatrice de la maison d’enfants, déclarait : "Pour ce qui est de Moissac... je dois dire qu’on est tombé dans un pays où véritablement la population a été extraordinaire... il y avait quelque chose dans ce pays-là qui a fait qu’il y a eu une protection de la population" 7.
"Protection", c’est bien le mot qui convient : les exactions policières, les déportations, n’ont pas eu lieu grâce, aussi, à la protection de la population. Protection passive (très peu de dénonciations - contrairement au reste du pays), protection active (fuites d’informations sensibles vers la Maison, fabrication à la mairie de faux papiers quasiment à la chaîne, planques chez les paysans ou dans les internats du coin), bref, un sentiment de protection tellement palpable que le commissaire de police nommé en 1941 à Moissac, bien qu’ouvertement antisémite, ne se hasarda pas à intervenir directement, que le commissaire de Castelsarrasin fera "choux blanc" (les enfants étant opportunément partis "en camping" juste avant) et que les nazis eux mêmes n’arriveront pas à attraper qui que ce soit sur place.
Qu’ils soient tous des enfants de Moissac !
Les Enfants de Moissac se prénommaient Ida, Simon, Itzhak ou Ruth. Ils venaient de Pologne, d’Allemagne, d’ailleurs mais aussi de toute la France. Aujourd’hui, d’autres enfants, aux prénoms tout aussi lumineux, des enfants venus d’encore plus loin - d’Afrique Noire, du Maghreb, de Tchétchénie, d’Asie..., poussés par le famine, la misère, la guerre, tremblent chaque jour : un contrôle au faciès, une arrestation à l’école, une rafle dans le quartier... et, que vont-ils devenir ?
Aujourd’hui comme hier... parallèle à la fois éclairant et trompeur. Tant de choses si semblables et tant d’autres si différentes ! Les périodes de l’histoire ne sont jamais une pure répétition. Evidemment. Ce n’est donc pas tant les similitudes factuelles qu’il faut y rechercher, mais la réflexion éthique qu’elles portent.
Qui étaient ces policiers français ? Si on enlève les antisémites chevronnés, minoritaires, il reste la grande masse des "je ne fais pas de politique" des "républicains", et même de ceux qui avaient eu leur carte dans des mouvements de gauche. Que disent-ils, à la Libération, quant ils sont tenus de s’expliquer ? Qu’ils n’ont fait que leur métier : appliquer la loi. Un point c’est tout 8. D’autres ajoutent qu’ils en auraient fait moins si leur hiérarchie n’avait pas eu pour obsession de "faire du chiffre" 9 Il n’y a pratiquement pas d’autres explications à leur conduite. Ainsi, la culture de l’obéissance et la culture du résultat ont couvert moralement l’organisation du génocide. Il faudrait y ajouter, pour la population générale, la culture de la résignation.
Là sont bien les véritables question soulevée par l’histoire des Enfants de Moissac. Dans notre période où il ne se passe pas de jour sans qu’une nouvelle loi soit promulguée, où toutes les institutions (de l’école à la justice en passant par le sport) ont fait du "rappel à la loi" leur lei motif, où les fonctionnaires sont menacés d’être payés "au résultat", où on tente de nous faire croire que le capitalisme (une fois moralisé) et l’Etat son compère sont indépassables... l’histoire, celle des Enfants de Moissac comme celle avec un grand H, nous rappelle que les "valeurs" d’obéissance et "d’efficacité" servies par la résignation portent en elles les germes des pires crimes d’Etat.
A Moissac, pendant la guerre, il n’y a pas eu de miracle. Simplement, probablement par hasard, une plus grande concentration ici qu’ailleurs de femmes et d’hommes pour la plus part sans rien de bien particulier, sinon une absence d’obéissance aveugle, une part d’imperméabilité au discours dominant ; des hommes et des femmes qui ont su, chacun avec sa force et sa personnalité, maintenir ce qu’ils étaient au quotidien, sans baisser les bras, et cela en pleine occupation. Ce qui nous prouve bien une chose : même aux pires moments, une opposition populaire peut enrayer la machine à broyer du pouvoir.
1 Les "démocraties" ont toujours su élever un "mur du silence" autour des vérités dérangeantes, ou même les censurer sans complexe. Ainsi, la première séquence du film "Nuit et Brouillard", d’Alain Resnais, a été censurée parce qu’elle montrait un gendarme français gardant le camp de Pithiviers. La guerre était finie depuis cinq ou six ans à la sortie du film, mais il était toujours interdit de dire la vérité sur le rôle de la police française de l’époque.
2 Catherine Lewertowski, "Les enfants de Moissac, 1939-1945, préface de Boris Cyrulnick, Champs histoire, 2009
3 Jean-Marc Berlière, "Policiers français sous l’occupation d’après les archives de l’épuration", Tempus, éditions Perrin, 2009
4 Jean-Marc Berlière, "Policiers français sous l’occupation d’après les archives de l’épuration", Tempus, éditions Perrin, 2009
5 Jean-Marc Berlière, "Policiers français sous l’occupation d’après les archives de l’épuration", Tempus, éditions Perrin, 2009
6 S. Klarsfeld, "Le calendrier de la déportation des juifs en France", 1993
7 Colette Zytnicki, "Moissac sous la Seconde guerre mondiale, il faut sauver les enfants juifs", Midi-Pyrénées patrimoine, n°6, avril-juin 2006
8 Quoique... cette allégeance de principe à la loi devient beaucoup plus aléatoire quand cela concerne directement des policiers. Ainsi, bien que cela soit désormais la loi, avant d’agir, un commissaire demande prudemment à "être protégés contre les mesures qui pourraient être prises demain contre eux les policiers par le gouvernement de demain pour avoir exécuté les ordres de celui d’aujourd’hui" - déclaration du commissaire Shirat, in Berlière, op. cit.
9 "Procès du commissaire Turpault, dans Berlière, op. cit....
Abolir la police

Tout le monde déteste la police
Cet ouvrage collectif au titre prometteur : 1312 raisons d’abolir la police dirigé par G. Ricardeau est un regard croisé d’autochtones du Canada, de travailleuses du sexe, de travailleurs sociaux, de militants associatifs, de professeurs et de chercheurs en sciences sociales. Suite à un constat partagé, ces différents acteurs argumentent afin d’engager un mouvement abolitionniste de la police qu’ils considèrent comme « iatrogène », dit autrement « la police crée le crime ». Ils entendent d’ailleurs police au sens large en englobant toutes les formes publiques ou privées de maintien de l’ordre et des privilèges : flics, vigiles, contrôleurs et autres matons. Leur constat est sans appel, la police au sens large [entendre toutes les instances de répression] est structurellement raciste, patriarcale, violente et agit bien souvent en toute impunité, il faut donc s’en débarrasser. En bref, une seule solution : l’abolition !
De plus les polices ont un coût (coup) « phénoménal » qui contribue à l’extension de « l’état pénal aux dépends de l’état social ». Elles furent d’ailleurs consubstantielles au développement du capitalisme et de fait de même nature, à savoir « parasitaire » pour la vie en société. L’objectif de l’ouvrage est donc sans ambiguïté : « en finir avec cette nuisance qu’est la police ». Ainsi tout réformisme de la police est illusoire compte tenu de son rôle incontournable dans la défense et le maintien du système de domination des capitalistes et des états.
Les différentes contributions qui constituent l’ouvrage sont des témoignages portés par les militant-e-s abolitionnistes aux USA et au Canada mais qui ont toutes leur portée et leur réalité dans l’hexagone. Le projet abolitionniste implique en effet de repenser toute la société et donc de s’attaquer à toutes les inégalités et aux idéologies qui légitiment l’emploi de la force au profit des dominants.
Les deux dernières parties « construire l’abolition » et « lutter contre la police » ouvrent quelques pistes de réflexion et d’action pour asseoir le mouvement abolitionniste. Mais, et c’est essentiel, « il ne peut y avoir une abolition de la police [condition sine qua non] sans abolition de la propriété privée et de la société de classes qui résulte du capitalisme […], et parce que vivre libre, c’est vivre sans police »
Pourquoi 1312 ? Sans doute pour un nombre infini de bonnes raisons de le faire
Hugues, groupe Commune de Paris de la Fédération Anarchiste
https://federation-anarchiste-groupe-commune-de-paris.over-blog.com/2023/03/tout-le-monde-deteste-la-police.html
Ricordeau G., dir., 1312 raisons d’abolir la police, Québec, Ed.Lux